|
Place de l'observateur dans la séquence : modification du milieu. |
| Incident extérieur, IE1, ligne 1 : le déclencheur est la modification du milieu par la présence de l'observateur par l'intermédiaire du microphone. |
La perturbation semble être locale puisque les élèves passent à la phase suivante sans autres commentaires. Ce type d'incident extérieur lié à la présence d'un observateur est récurrent et peut être interprété comme un élément de négociation du contrat d'observation. |
|---|
|
Il s'agit d'une phase de négociation du contrat ; les élèves souhaitent être guidés par le professeur et le professeur souhaite que les élèves travaillent en autonomie, estimant que l'élément de milieu matériel constitué par l'énoncé est suffisant. |
|
Dans ce dialogue, E1 et E2 entrent dans la réalisation effective de la figure sur l'ordinateur. Les questions qu'ils traitent sont reliées aux notations et aux gestes nécessaires pour construire et nommer un point dans une conversion du registre de la langue naturelle dans le registre de représentation du logiciel. |
| Incident syntaxique, IS1, ligne 15 : dans le registre du logiciel la syntaxe sera atteinte par le geste. |
La perturbation est ici très locale du fait de l'aide de E1. |
|---|
|
Représentation du point de coordonnées (1,1) |
|
Tentative de construction du point comme intersection de deux droites définies par leurs équations. |
| Incident syntaxique, IS2, ligne 20 : il s'agit de placer un point dont on connaît les coordonnées ; dans le registre de représentation de la feuille de papier, ce geste est naturalisé en terminale ; en revanche, il n'est pas naturel sur le logiciel comme on le voit ligne 22. |
La perturbation se prolonge jusqu'à une aide extérieure (épisode suivant) et provoque une bifurcation didactique : les élèves investissent une situation adidactique différente de celle proposée par le professeur : il s'agit de construire le point de coordonnées (1,1) à partir des outils mathématiques disponibles : lignes 29-32.
Ligne 35 : E2 tente de demander un arbitrage au professeur qui n'est pas disponible à cet instant. L'incident syntaxique a provoqué une bifurcation didactique par investissement d'une branche adidactique marginale. |
|---|
|
Retour à la situation initiale : un élève, S, replace E1, E2 et E3 dans la situation objective proposée par le professeur. |
|
Explications pas à pas de la syntaxe du logiciel. |
| Incident de frottement, IF1, ligne 46 : j'ai rien compris à ça ; les deux protagonistes sont à ce moment dans une situation objective différente. C'est ce décalage dans la structure des milieux qui est déclencheur de l'incident.
|
La perturbation est d'abord locale : S reprend pas à pas les explications syntaxiques ; E1, E2, et E3 sortent petit à petit de la branche marginale de la situation. La perturbation se prolonge à plus long terme. La situation prévue et maintenant comprise est moins intéressante pour les élèves que celle imaginée : épisode suivant ponctué, ligne 70 par : C'est pareil... Ça me gonfle... provoqué par une remarque du professeur concernant les noms des points En majuscule, les points s'il vous plait. |
|---|
|
Épisode de perturbation-décrochage et manipulations automatiques : la tâche de construction n'est liée qu'à des gestes techniques ; on voit ici la séparation du problème de mathématiques et de la représentation dans la syntaxe du logiciel des données sans réflexion sur la situation mathématique et l'entrée dans la branche nildidactique décrite dans l'analyse ascendante. |
|
Intervention du professeur sur une interrogation des élèves. Le professeur avait prévu cette question et renvoie les élèves vers l'énoncé. Dans le même temps, la réponse renforce la branche nildidactique que les élèves ont investie en montrant comme élément essentiel du milieu la représentation de la situation. A la suite de cette intervention, il y a deux réactions suivant les élèves que l'on observe dans l'épisode suivant. |
| 1) Le dialogue qui suit concerne le professeur et un élève E de la classe en réponse à l'intervention précédente :
P : Oui de 0 à 2 . C'est ça que tu veux faire ? . C'est ça que tu veux faire ?
E : C'est la même chose.
P : Oui, oui, bien sûr.
E : Bon, ben c'est bon.
P : Mais pour la deuxième question, qu'est ce qu'il suffit de montrer simplement ? |
Dans cet extrait, différents niveaux de langages apparaissent : la question posée par l'élève est d'ordre technique (le logiciel ne fait pas ce que cette élève souhaite). Marie répond en renvoyant aux explications données sur les fiches (page 2 et 3 figure enonce15janv) ; l'élève reprend alors sur une question d'ordre mathématique (est-il équivalent de faire varier la mesure de l'angle entre 0 et  ou entre ou entre  et et  ?) ; du coup les explications de l'énoncé n'ont plus de sens. Le professeur passe alors à autre chose sans que l'incident ne soit réglé. Dans cet extrait E-1 dans une situation S-1 ne rencontre pas P-1. ?) ; du coup les explications de l'énoncé n'ont plus de sens. Le professeur passe alors à autre chose sans que l'incident ne soit réglé. Dans cet extrait E-1 dans une situation S-1 ne rencontre pas P-1. |
| 2) Ce dialogue concerne les trois élèves observés.
|
Interrogation sur le but de l'activité : l'intervention de E3 provoque une discussion sur les contrôles, les notes... |
| Incident de contrat, IC1 : ligne 83. |
L'incident débouche sur une perte de dévolution de la situation locale (digression) ; le retour à la situation se fait ligne 90 (Pourquoi ?... Ah oui ben forcément) où E1 lit et montre le paragraphe pointé par le professeur et ramène ses camarades à la confrontation à cet élément du milieu matériel. La perturbation resurgit un peu plus tard, ligne 163 et suivantes (Apparemment y'a M. qui a tout trouvé). |
|---|
|
Réflexion sur la justification de la construction |
Incident syntaxique, IS3 : ligne 92 ; typiquement, il y a ici confrontation des registres de représentation de l'objet mathématique angle orienté. D'un point de vue algébrique, la manipulation des symboles  , ,  conduit à l'égalité : conduit à l'égalité :
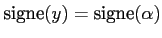 qui est vérifiée dans le registre graphique et sur la représentation construite et qui est justifiée par les élèves à partir de leurs connaissances. En revanche la traduction n'est pas prévue par le logiciel (d'où le calcul proposé par le professeur). C'est la confrontation au milieu qui déclenche cet incident. qui est vérifiée dans le registre graphique et sur la représentation construite et qui est justifiée par les élèves à partir de leurs connaissances. En revanche la traduction n'est pas prévue par le logiciel (d'où le calcul proposé par le professeur). C'est la confrontation au milieu qui déclenche cet incident. |
Le professeur attendait que les élèves comprennent ce qu'elle appelle l'astuce (ligne 81) sans que le registre ne soit précisé. La conséquence de l'incident est une réalisation des tâches techniques sans retour vers la justification mathématique, c'est-à-dire un renforcement de la position des élèves dans la branche nildidactique. |
|---|
|
Réalisation pas à pas de la figure. |
| Incident syntaxique, IS4 : ligne 108 ; déclenché par l'interaction avec le milieu (dysfonctionnement du logiciel), l'étiquette désignant l'objet se superpose à l'objet empêchant de le désigner avec la souris comme illustré sur la figure ci-dessous :
Incident déclenché par un dysfonctionnement du logiciel
|
Deux perturbations sont conséquences de cet incident : un perturbation à court terme dans l'épisode suivant et à long terme sur la légitimité de l'usage du logiciel dans la classe de mathématiques. Cette deuxième perturbation se nourrit des différents incidents syntaxiques rencontrés dans les épisodes précédents.
Cet extrait montre bien la perturbation créée par l'incident qui dans un premier temps débouche sur une digression complète ( elle a pas corrigé les contrôles ) qui se poursuit quelque trente secondes, puis se poursuit par une relecture de l'énoncé et se conclut par la réflexion de E1 qui, du coup abandonne la réflexion mathématique concernant les angles pour se ramener à une tâche technique ( Stocker dans un coin de l'écran la mesure de l'angle géométrique  ... ). La branche nildidactique décrite dans l'analyse ascendante est investie. L'investissement est d'autant plus fort que la justification mathématique de la construction n'est pas considérée comme faisant partie de la tâche prescrite. ... ). La branche nildidactique décrite dans l'analyse ascendante est investie. L'investissement est d'autant plus fort que la justification mathématique de la construction n'est pas considérée comme faisant partie de la tâche prescrite. |
|---|
|
Le discours du professeur est en décalage avec la position des élèves dans la réalisation de l'expérience. |
| Incident de frottement, IF2 : ligne 109, est déclenché par l'interaction du professeur et des élèves.
Les élèves sont dans la situation S-2 et le professeur les interpellent comme E-1. |
La perturbation se termine lorsque le professeur comprend la position des élèves et prend en compte l'incident syntaxique précédent. |
|---|
|
Long épisode pour essayer de régler le problème créé par l'incident syntaxique précédent. L'intervention du professeur renforce la branche marginale de la situation, la recherche d'explications est donnée en terme de conversion de registres (du langage naturel au langage du logiciel) sans interprétation mathématique liée au problème posé.
Cet incident est déstabilisant pour Marie qui ne sait comment le régler : Je propose de le nommer autrement ... fais moi bouger, là... non il faut que la main soit comme ça... . Marie finit par abandonner, en faisant une remarque à un autre élève (ligne 128), s'éloigne et revient vers le groupe sur sa dernière remarque (le zoom effectué ayant transformé le repère initial en un repère non orthonormé). |
|
Question décalée du professeur : le professeur a aperçu sur un écran voisin un cercle représenté à l'écran dans un repère non orthonormé, le professeur demande de rectifier. |
| Incident de frottement, IF3, ligne 133 : les élèves, à ce moment sont sur une autre question. C'est l'interaction professeur-élève qui est déclencheur de l'incident. |
Perte de dévolution (ligne 139). Le retour à la situation montre un rejet de la partie expérimentale (ligne 142).
On peut penser qu'à cet instant, cet élève se place dans une situation S+1 et rejette l'entreprise de la situation nildidactique par rapport aux contrat compris de la classe. Cette partie théorique doit (devrait) apparaître et mettre un terme à la situation nildidactique dans lequel il est enfermé.
La perturbation créée est plus profonde et provoque une digression longue et une nouvelle perte de contact avec la situation, proche de l'abandon, en témoigne la longue digression (lignes 140-141) puis le Y'a pas une partie théorique ? (ligne 142) où E2 souhaite abandonner le travail sur logiciel, répondant de fait à la position déjà notée de P0, pour se consacrer à la partie théorique du problème. |
|---|
|
Transition ; dans cet épisode, E1 lit l'énoncé et est ramené au problème de mathématiques à traiter. |
| Incident de frottement, IF4 : ligne 143 est déclenché par la confrontation au milieu. |
La perturbation que l'on trouve dans cet épisode est le résultat des incidents syntaxiques précédents qui ont provoqué une perte de sens et une volonté de sortir de la situation nildidactique. |
|---|
| Incident extérieur : le téléphone de E1 vibre et il se penche pour arrêter le vibreur (ligne 150 : Merci, E2 !) |
Perturbation locale. |
|---|
|
Décalage entre les positions des élèves dans la structure des milieux. |
|
Digression |
| E2 se situe dans la situation de référence et se confronte au milieu objectif résultant de son expérience alors que E1 se trouve dans la situation objective et se confronte à un milieu matériel qu'il n'arrive pas à maîtriser. |
La conséquence de cet incident est encore une perte de dévolution représentée par une digression sur le dernier contrôle en attendant une intervention du professeur (lignes 165-172). |
|
Essais de résolution de l'incident : le professeur propose plusieurs stratégies qui ne réussissent pas. Il y a un conflit entre la nécessaire gestion du temps (chronogénèse) et la nécessité de faire avancer la situation (topogénèse) ; ce conflit alimente la perturbation. |
|
La suite du dialogue montre encore une fois une perte de l'investissement de la situation objective ; les élèves sont dans une phase de renégociation du contrat ; puisque l'outil ne fonctionne pas comme prévu par le professeur dans la situation objective et que ce dernier ne peut pas modifier cet état de fait, le problème posé apparaît comme illégitime. |
| |
La perturbation se prolonge parce qu'aucun élément ne vient rétablir la dynamique. Le couple élève-professeur ne peut seul se sortir de la perturbation. |
|
Le professeur s'extrait de cette position externe et se place dans la situation didactique en entrainant les deux élèves E1 et E2 : Au fait, vous avez réfléchi à la question avant de voir ce que donne l'écran ?, ligne 182. |
| Incident de frottement, IF5, ligne 182. Les sujets de l'incident sont cette fois les deux élèves qui sont transportés dans la situation S0 alors qu'ils étaient en train d'investir la situation S-1 après les expériences menées dans S-2. |
Un problème d'enregistrement audio empêche ici de suivre la perturbation immédiate, mais dans les dialogues, les élèves sont sur l'interprétation de l'expérience (Le maximum, il est là, le minimum il est là, ligne 187 alors que le professeur essaye de les amener à une argumentation mathématique. Devant la mise en danger de la perturbation précédente, le professeur revient à un contexte sûr et maîtrisé : l'argumentation mathématique. En s'appuyant sur les réussites des élèves, Marie précise ses intentions et minimise la portée de l'incident: Au fait, vous avez réfléchi à la question avant de voir ce que donne l'écran ? (ligne 182). |
|---|
|
La perturbation se prolonge, l'incident ne pouvant être résolu. Marie essaye alors de modifier la situation objective en dirigeant vers une expérience mentale les élèves, qui eux, restent fixés sur les objets concrets de l'expérience : Oui, ça varie beaucoup... , le maximum il est là et le minimum il est par là . La dynamique emprunte une trajectoire qui tend à faire perdre tout investissement aux élèves, le professeur essaye de recréer un milieu matériel en adéquation avec ses intentions; la négociation du contrat est dans cet extrait tout à fait fondamental pour rétablir la dynamique. |
|
Incident créé par une utilisation non contrôlée du logiciel
|
Le problème précédent a été résolu par l'élève qui a entièrement recommencé la tâche. Les trois élèves sont dans la phase de représentation du nuage de points. |
| Incident syntaxique, IS5 : ligne 189 ; E2 a obtenu le dessin de la figure ci-dessus. Le professeur propose de refaire la construction. |
La perturbation est ici assez profonde puisque E2 se trouve dans une position où il ne peut comprendre l'erreur commise. Le milieu n'a pas joué son rôle dans la situation S-2 et le professeur ne peut pallier ce manque dans la situation S0. |
|---|
|
Changement de regard : le professeur dans la posture P-1 abandonne le problème pour valider les représentations obtenues par les autres élèves ; il y a ainsi des allers-retours entre la validation des nuages obtenus.
Il est ici intéressant de détailler le type de cet incident qui a priori est un incident syntaxique (la syntaxe erronée fait que le logiciel rend un résultat différent de celui qui est attendu) mais qui peut être expliqué d'un point de vue mathématique et informatique. Le logiciel stocke à partir de la figure de géométrie les variables, résultats de mesures sur le dessin, dans deux listes écrites dans le tableur, les abscisses et les ordonnées des points du nuage. Dans l'application graphique, le logiciel représente le nuage de points en parcourant parallèlement les deux listes pour extraire l'abscisse et l'ordonnée des points du nuage. Le dessin chaotique de la figure précédente ne peut donc provenir que d'une désynchronisation de ces deux listes qui n'apparaissent pas sur l'écran principal (Figure ci-dessous). Une remise à zéro suivi d'une nouvelle expérience permet de régler ce problème.
Illustration du fonctionnement du logiciel
|
|
L'incident syntaxique (ligne 189) est dû à une incompréhension du fonctionnement informatique du logiciel tant de la part des élèves que du professeur. Cette insuffisance crée une perturbation locale importante tant pour les élèves ( Ils sont sensés se planter comme ça, le jour de l'exam au bac là ? ) que pour le professeur, qui se trouve dans une position délicate : Et puis, si jamais il y a un problème, on vous... on en tient compte... où le Marie commence sa phrase comme elle pourrait le faire pour régler un problème de mathématiques : si jamais il y a un problème on vous aidera , mais se reprend : on en tiendra compte .
Cette perturbation locale se répercute sur une perturbation globale lié à une prise de distance vis-à-vis du logiciel et de la calculatrice de la part de ces élèves et du professeur, comme l'exprime Marie à l'issue de l'observation : |
Marie : Et oui, ah oui, malheureusement, mais pour le contrôle, pour le dernier contrôle, ils s'en sont tellement servis que, rires que s'ils donnent le résultat sans explications, c'est zéro, quoi ! Oui, ça, là, ils commencent à devenir, pénibles. Ça, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Non, moi, je crois que, enfin, je ne sais pas ce que pensent nos grands pontes, mais, on se tourne vers le modernisme, d'accord, mais il faut faire une épreuve avec et une épreuve sans, que ce soit clairement dit, quoi ; parce que, ou alors, je sais pas, moi, c'est, voilà on apprend plus rien ou alors on raisonne complètement autrement. Ah non, non, non, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe pour les élèves moyens et faibles, enfin moyens encore ils se rendent compte que,... Mais alors les élèves faibles, ils me rendent les résultats d'intégrale, ils ne se rendent pas compte que... Si moi, je dois réfléchir en corrigeant,... Donc ça, ça devient un problème, parce que justement les miens, relativement à la classe de ma collègue, je compare pas avec J., parce que J., il est... Mais ils sont plus accrochés à la calculatrice, parce que ceux de ma collègue, même en contrôle, la calculatrice, ils dominent pas. |
|
Double dialogue : le professeur valide et invalide les résultats obtenus pour les élèves qui ont obtenu la représentation souhaitée et cherche par ailleurs à résoudre le problème rencontré au moins deux fois dans la classe : A. aussi, il a eu ça ? (ligne 234). |
| Incident de contrat, IC2, ligne 235 : perte de confiance dans l'artefact. |
La perturbation se prolonge jusqu'à la fin de la séance, puisque le professeur n'a pas su régler le problème. Il y a un double effet : d'une part une perte de confiance dans l'artefact et dans la possibilité d'expérimenter en mathématiques avec cet artefact, et d'autre part un renforcement de l'instrumentation du fait des nouvelles connaissances mises en évidence sur le fonctionnement du logiciel. En revanche, il n'y a pas d'institutionnalisation de ces connaissances. |
|---|
| |
|